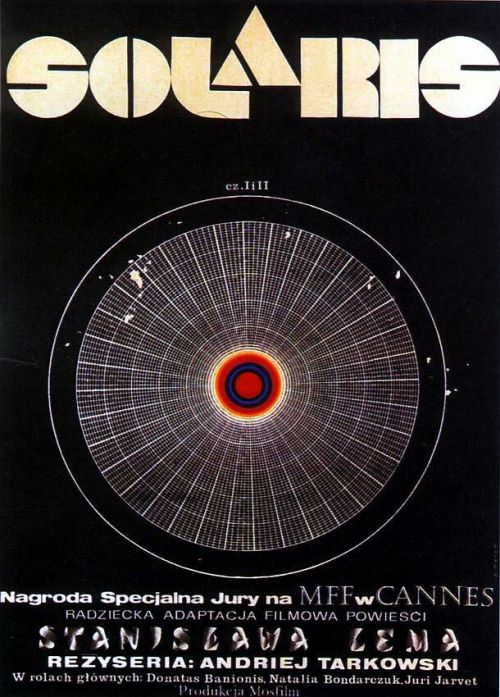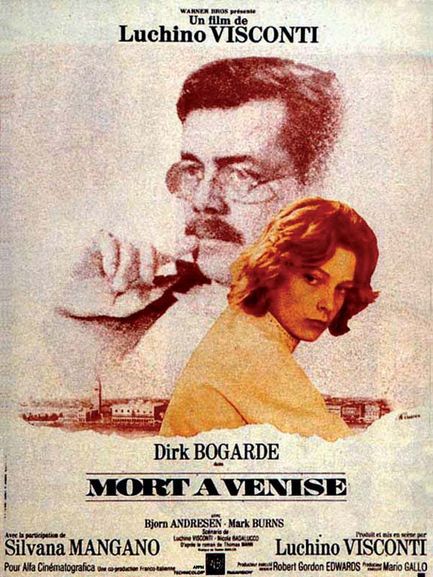Top 10 de la mort qui tue (ou pas)
Suite à une vague violente de "faisons gaiement des petits podiums (en fait, on dit "podia") sur les films" voici venu le temps des rires et des chants, des enfants heureux et des films qu'il faut tout même avoir vu 4 fois et autant à l'envers pour pouvoir draguer Mlle la Comtesse de Kerlaroche au Borde-Lo - l'héritière de cette fameuse famille noble bretonne.
Ainsi donc, ci-après suivra un petit recensement décroissant et personnel des films qu'il faut avoir vu avant de s'exiler sur une île déserte et le regretter amèrement.
Ce recensement dénombre ainsi 10 films ou "séries de films" (diptiques, trilogies, tétralogies, infinologie...) que je considère comme incontournables. Et que, vous aussi par la force des choses et mon charme ravageur, finirez par idolâtrez.
L'ordre n'est pas véritablement absolu, il sert juste à se repérer. Le classement donné peut effectivement varier en fonction des humeurs... mais les films cités resterons les mêmes !!
Numéro 10
The Rocky Horror Picture Show
Jim Sharman (1975)
Il le fallait, il le fallait, il le fallait. Un tel toptène ne pouvait commencer sans sa dose de kitsch, de glamour, de rock, de vulgaire et de licencieux obligatoire.
Suivant donc les aventures nocturnes de Brad Majors – Barry Botswick – et de Janet Weisz – excellente Susan Sarandon – tous deux jeune amoureux innocents et un rien naïfs, l’on se retrouve très vite plongé au cœur du château de l’horrible Dr Frank-N-Furter - Tim Curry sous acides - travesti vamp aux mœurs étranges…
Au son d’un rock psychédélique et totalement jouissif, le scénario enchaîne les situations cocasses et étranges, le film ayant qu’une cohérence très relative – mais non éclaté, non plus, rassurons-nous. Dans cette parodie des filmsd’horreur, des comédies musicales, des comédies romantiques, des films de science-fiction, de la vie en général, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes et du jambon en tranche (rappel d’une formidable scène d’un noir drôlatique à s’en décrocher la mâchoire) toute fuse en vue de faire réagir le spectateur, de le déranger en chamboulant totalement ses références habituelles.
« It’s the pelvis thrust that makes you insane hey hey hey ! Let’s do the Time Warp again ! »
Numéro 9
Ridicule
Patrice Leconte (1995)
Avec Ridicule, Patrice Leconte a véritablement réalisé son meilleur film. Représentant la cour de France sous Louis XVI, où le bon mot n’a d’ennemi juré que le ridicule, le réalisateur nous montre les efforts développés par un noble de province, Grégoire Ponceludon de Malavoy, cherchant à intervenir auprès du roi pour assécher des marais, nids à moustiques vecteurs de maladie décimant la population de son fief. Arrivé à Versailles, il devra batailler ferme, à coup d’esprit, pour se faire une place dans la cour et commencer à exister, afin que le roi, peut-être, lui accorde une entrevue.
Si le film brille, c’est en raison de nombreuses choses. Les acteurs, tout d’abord. Quel plaisir de voir Charles Berling, Jean Rochefort, Fanny Ardant et Bernard Giraudeau jouter pour savoir qui aura le plus fin trait d’esprit. Les dialogues, ensuite, par leur puissance et leur précision, retranscrivant cet esprit si français (hélas) d’humiliation perpétuelle d’autrui. Et la mise en scène, enfin, pour une peinture réaliste d’une France passée, mais Ô combien encore actuelle…
La force de ce film est qu’il présente, véritablement, ce qui sous-tend notre culture à savoir le bon mot, appelé actuellement « la vanne » ou « la pique », mais aussi – et surtout – cet esprit de cour encore très – trop – présent, cette envie de s’approcher du Soleil, au risque de s’en brûler les ailes : il faut exister non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous paraissons.
Numéro 8
Laitakaupugin valot
Aki Kaurismäki (2005)
Dans « Les Lumières du Faubourg » de Kaurismäki, l’on suit la vie de Koistinen – impeccablement interprété par Janne Hyytiäinen – un gardien de nuit qui rêve de se construire un petit coin de paradis. Hélas, la force et surtout l’inertie de la société l’empêchent de réaliser ses rêves alors qu’il se fait piéger par son propre amour.
Le film est une véritable analyse de la société finlandaise actuelle mais peut aisément être élargie à n’importe quel autre pays. Koistinen est seul, il vit dans la capitale, dans un minable trou à rat en sous-sol, fait son travail du mieux qu’il peut, ne récolte aucun crédit pour cela sinon des coups, rêve d’avoir une vie meilleure et fait tout ce qui est à son niveau pour s’en sortir. Hélas, contrairement aux héros chanceux de Au loin s’en vont les nuages du même réalisateur, Koistinen est prisonnier. Prisonnier de cette société qui le refuse, qui en vient à nier tout individu dans son individualité, qui rejette quiconque cherche un peu à aller à l’encontre de son destin tracé. Il n’est rien, les quelques puissants sont tout. Et ils décident. Le seul véritable moment où Koistinen sourit, où il vit, est véritablement le moment où il est physiquement enfermé – prisonnier – mais où, enfin, son esprit est libre, en accord avec lui-même. Tout redevient possible, un nouveau départ l’attend, tous les espoirs sont permis, le soleil brille, les fleurs repoussent.
Mais rien de cela n’existe, l’on est condamné de naissance, prédestiné. Le soleil est finalement un leurre dont les rayons nous mentent.
Numéro 7
2001 : A Space Odyssey - Solaris
Stanley Kubrick (1968) – Andreï Tarkovski (1972)
Deux films de science-fiction à même hauteur pourquoi ? Parce que les deux films se téléscopent, le soviétique répondant à l’occidental.
Soit d’un côté la découverte d’un monolithe ayant donné la science à l’homme, pur artefact divin – ou machine extra-terrestre ? – qui viendra faire renaître la nouvelle humanité, son futur, mécanique, robotique, mais d’une quelque manière éternelle
Soit d’un autre l’étude d’un planète présentant des incohérences, des cosmonautes obligés d’en repartir, des souvenirs qui resurgissent, des fantômes qui reviennent, une vie humaine physiquement différente.
Deux visions de l’Homme.
Soit tout d’abord une vision nietzschéenne du film, l’homme étant un équilibriste entre le singe et le surhomme, mais aussi comme évolution de la symbiose entre l’humain et la machine : du singe l’on passe à l’homme par le biais du monolithe – de la science – puis l’ordinateur devient humain, pour permettre à l’homme de n’être finalement que pur esprit.
Soit autrement une vision de l’homme plus interne. Qu’est-ce qui fait que l’Homme est Homme ? Sommes-nous humains, véritablement, ou bien nos propres définitions nous dépassent-elles aussi jusqu’à nous travestir ? La vie interne de l’Homme est véritablement ce qui le construit, et non ce qu’il devient, fait, ou peut faire.
D’un côté l’expansion, de l’autre l’étude de soi.
Deux incontournables de la science-fiction par leur « simple » aspect artistique mais aussi par les réflexions qu’ils engendrent. A noter que chacun des deux films est libre d’interprétation…
Numéro 6
Morte a Venezia
Luchino Visconti (1971)
Certes, on fera facilement remarquer que le film est lent, qu’il se passe peu de choses et que la passion qui y est filmée est plus que douteuse. Il n’empêche que, dans cette adaptation d’une nouvelle de Thomas Mann – majoritairement autobiographique – la réflexion que nous livre Visconti sur l’art et la beauté est sans commune mesure. Soit Gustav von Aschenbach, compositeur incarné par Dirk Bogarde, référence évidente à Mahler admiré des deux Mann et Visconti, compositeur en perte d’inspiration, dont tout talent s’est comme évaporé, en voyage à Venise pour se ressourcer. Il y croise Tazio, un adolescent en lequel il voit la représentation ultime de la beauté, ce à quoi il tentait toujours d’atteindre. Reprenant vie et rajeunissant – presque littéralement – à ce que lui apporte la vision du jeune homme –ils ne se parlent jamais – Aschenbach le suivra pour l’épier, sa passion prenant un caractère encore plus pervers (oui, c’est possible) et, bien évidemment, morbide, que l’épidémie de choléra tend à souligner.
La musique de Mahler accompagne le film et cadre mieux que tout chaque scène, permet de faire resurgir les angoisses, les tourments mais aussi les sentiments et les émotions qui traversent Aschenbach quant à l’endroit de Tadzio, amoureusement filmé, comme l’écrira Lawrence J. Quirk : « Some shots of Björn Andrésen, the Tadzio of the film, could be extracted from the frame and hung on the walls of the Louvre or the Vatican inRome. For this is not a pretty youngster who is supposed to represent an object of perverted lust; that was neither novelist Mann's nor director-screen writer Visconti's intention. Rather, this is a symbol of a beauty allied to those which inspired Michelangelo's David andDa Vinci's Mona Lisa, and which moved Dante to seek ultimate aesthetic catharsis in the distant figure of Beatrice. »
Numéro 5
Star Wars
(trilogie originelle, episodes IV, V et VI)
Georges Lucas/Irvin Kershner/Richard Marquand (1977/1980/1983)
Il est impossible de ne pas citer cette trilogie, certes « kitsch » car space opera, certes très stéréotypée avec ses personnages issus de films de cape et d’épée et de buddy movies, certes certes certes… mais éminemment inventif et prenant. L’histoire de la sempiternelle lutte entre le bien et le mal sur fond de guerre – croisade même – galactique et de chevaliers Jedi est une resucée de nombreux mythes qui, non content de les remettre au goût du jour, sait les utiliser intelligemment et les modifier suffisamment pour éviter le cliché et le mauvais goût. Tout dans ces films y est prenant, les dialogues – incisifs entre Han et Leia – les batailles – le combat sur Hoth est l’une des meilleures que la science-fiction ait vues jusqu’ici – les personnages – le charisme de Dark Vador, porté par la géniale musique de John Williams – tout cela donne un film que l’on voit et revoit sans pour autant se lasser. A ce jour, votre humble serviteur a dû visionner pas moins de 15 fois chaque film…
L’imaginaire de Georges Lucas emplit les films et bouche chaque petit trou d’où l’on aurait pu pointer une quelconque incohérence. Tout se tient, tout est crédible et si parfois le tout peut sembler manichéen, la fin grandiloquente du Retour du Jedi montre que, finalement, bien ou mal, rien n’est absolu ni inéluctable.
Je ne dirai rien sur la trilogie la plus récente, regardable et sympathique, mais foutrement incohérente.
Numéro 4
Once upon a time in the West
Sergio Leone (1969)
LE western spaghetti par excellence, mené d’une main de maître et entrecoupé de plans les plus hallucinants les uns que les autres. Ou l’histoire d’un homme sans nom – comme souvent chez Leone – à la poursuite d’un objectif, obscur, inconnu. Construit à peu de choses près comme une tragédie grecque - oui, osons l’hérésie et le blasphème apparent – le film suit les traces de trois protagonistes. Le joueur d’harmonica d’abord, porté par Charles Bronson, suintant de virilité et de mutisme dont les yeux sont deux canons plus mortels encore que le pistolet qu’il a autour du cou. Frank, sous les trait d’Henry Fonda, une gâchette vendue au plus offrant voulant s’offrir le monde, une ordure habituelle, un salaud pourtant humain, l’opposé du joueur d’harmonica, un homme bon inhumain. Et Jill McBain, la splendide et magnifique Claudia Cardinale, peut-être la plus virile de tous les personnages machistes dont elle se retrouve entourée, femme abandonnée – sa nouvelle famille a été massacrée – en proie à la folie dominatrice de ses congénères phalliques.
Le rythme lent et poussiéreux du film, porté par la musique lancinante d’Ennio Morricone renforce toute la tension et l’angoisse portées par chaque individu, jusqu’à mener à la catharsis finale, le face-à-face entre l’harmonica et Frank, l’un des plus beaux duels, des plus violents, des plus essoufflant, des plus extraordinaires qui soient.
La morale que pourrait apporter le film est que, dans un monde perverti par l’avarice, l’orgueil et la mesquinerie humaine, seule la confiance et finalement un peu d’abnégation peuvent permettre à la société de revivre : le sacrifice de Cheyenne n’est pas vain, il aura permis à une nouvelle ville de naître.
Numéro 3
M – Eine Stadt sucht einen Mörder
Fritz Lang (1931)
Le premier film parlant de Fritz Lang est définitivement un incontournable à visionner immédiatement. L’histoire de cet assassin d’enfant semant la panique parmi toute la population de Düsseldorf est d’autant plus fascinante qu’elle est – comme souvent avec Lang – une véritable critique politique. La pègre, et notamment lors de la scène finale du procès, n’est pas sans rappeler les nazis que, dès 1931 pourtant, Lang craignait déjà. A l’histoire policière – la recherche de l’assassin, s’ajoute donc une charge violente contre l’ascension du fascisme en Europe et les répercussions de la dépression en Europe.
L’étude psychologique des personnages, dont bien évidemment de Hans Beckert, l’assassin, admirablement campé par un Peter Lorre – pourtant habitué au muet – dans toute son excellence, est formidablement poussée, nous montrant les différentes facettes de l’être humain dans ce qu’il peut avoir de plus odieux et de plus noir, et ce de manière totalement atemporelle et – si l’on peut dire, universelle. La symbolique de la main droite « trahissant » l’assassin à la vindicte populaire, anonymement, est malheureusement un trait qui se retrouve à toute époque, ainsi que l’excitation grégaire que l’appel du sang stimule.
L’interrogation finale n’est rien que l’apogée du génie de ce film, alors que l’on se demande si l’on doit, finalement, haïr le meurtrier et le lyncher ou plutôt le prendre en pitié…
La maîtrise des plans et des champs renforcent l’admiration ainsi que l’utilisation – maintenant habituelle, mais révolutionnaire alors – du leitmotiv pour épingler les personnages : Dans le hall du roi des montagnes du Peer Gynt de Grieg devient non seulement le leitmotiv du tueur mais aussi son chant funèbre, car il fera démasquer par la pègre. Le spectateur, quant à lui, aura eu une distance d’avance en ayant vu son ombre masquer le vil « Mörder » sur la colonne d’affichage…
Numéro 2
Rashōmon
Akira Kurosawa (1950)
L'histoire d'un bandit qui dévalise un couple. Le mari qui défend sa femme. Ou qui la méprise. Ou qui fuit. Le bandit au grand coeur. Le bandit assoiffé de sang. Le bandit qui est un homme faible. Ou fou. La femme qui est victime. Ou manipulatrice. Et assassine.
Rashomôn est sans contestation possible LE film qui a le mieux traité la subjectivité humaine. Quelle version de l'histoire est correcte ? Y en a-t-il seulement une qui soit correcte ? Est-ce que le fait même d'être exact existe ? Tout n'est-il pas que question d'interprétation ? A travers son fait divers raconté de quatre façons différentes, Kurosawa nous invite à réfléchir au crédit que l'on peut donner à une histoire et surtout au fait qu'il n'existe, finalement, pas qu'une réalité absolue, car chacun donnera une version purement subjective, dans laquelle il paraîtra forcément élevé et niera sa lâcheté, ses faiblesses, la honte qu'il peut inspirer. Ainsi le bandit, Tajōmaru, parlera d'une grande bataille afin de conserver sa réputation de brigand, la femme acceptera sa faute - d'une certaine manière - en disant avoir poignardé son mari, le samouraï trépassé présente aussi une histoire intéressante dans laquelle il en ressort moins défait, moins amoindri dans son statut de samouraï si tant est que l'esprit parle vraiment. Mais ne serait-ce pas le médium qui donne une version des faits apaisant les troubles des survivants ? Que dire du bûcheron qui n'a pas osé parler devant le juge ?
Si à cela l'on ajoute un traitement de la lumière pour le moins équivoque - la lumière est-elle néfaste ou non ? - ainsi qu'un performance d'acteurs exceptionnelle (nous n'allons pas nous étendre plus sur l'immense talent de Toshirō Mifune), l'on obtient un film qui est un incontournable.
Numéro 1
Underground
Emir Kusturica (1995)
Comment n'aurais-je pu citer dans un tel tauptène LE film d'Emir Kusturica sur l'histoire de la Yougoslavie ?
Underground relate l'histoire de trois amis - Petar Popara, un "lignard", un simple électricien, Marko, l'intellectuel et Natalja, l'artiste - représentant les trois forces d'un pays initialement en guerre et leur évolution au cours du temps, leurs jeu d'influences, de pouvoir et bien évidemment de manipulations.
Loin d'être un simple pamphlet dénonçant l'époque titiste ce film est, de surcroît, une excellente analyse de caractères. si chaque personnage n'est qu'un représentant d'une partie de la population et l'incarne dans sa globalité, le film n'est pas pour autant un simple étalage de pions qui nous serviraient à expliciter l'Histoire. Chaque personnage vit, chaque personnage est. Les jeux de couleurs, pastels lors de la Seconde Guerre Mondiale et virant au rouge infernal lors de la guerre de Yougoslavie, mettent en avant le ressenti du cinéaste pour chaque époque, pour chaque vision du monde qu'elle portait, et pour chaque histoire. Car le film est divisé en plusieurs chapitres consécutifs, chacun entraînant un peu plus les protagonistes vers la folie et l'horreur la plus abjecte. Pour exemple, du bombardement - déchirant, il faut bien l'avouer - du zoo de Belgrade par les forces aériennes nazies, au tout début du film, l'on finit sur un village en feu où tout est mort : les hommes ont remplacés les animaux, la régression est achevée, l'horreur a atteint son absurdité la plus totale, après être passée par le meurtre - dont le fratricide...
La fête, comme toujours chez Kusturica, est omniprésente mais contrastant violemment d'avec son rôle usuel : là où, d'ordinaire, la fête est un moment de transgression, ici elle est le lieu où tout est calme - sous un chahut apparent - où les hypocrisies resurgissent, ou l'hybris n'est plus exacerbée. Son rôle cathartique n'est plus, les règles sont inversées : la réalité est transgression.
Sans débattre plus sur la puissance psychologique - Ah ! Quels caractères ! - politique - Ah ! La charge critique envers l'Europe est cinglante - artistique - Ah ! La musique de Goran Bregovic ! - et purement passionnelle de ce film - Ah ! Comment ne pas être ému ? Comment ne pas être déchiré ? - il ne reste qu'à le recommander chaudement, car il demeure un chef-d'oeuvre non seulement de maîtrise technique mais aussi émotionnelle encore peu égalée.